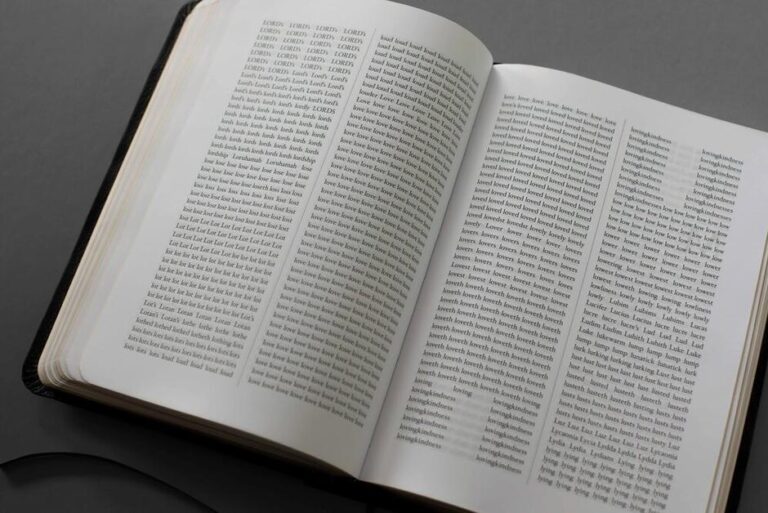Depuis 1947, le peuple balti est séparé entre l’Inde et le Pakistan. Alors que les tensions sont très vives entre les deux pays, il lutte pour préserver son identité et utilise la poésie et les réseaux sociaux comme armes de résistance culturelle. État des lieux côté indien.

Au bord de la piste poussiéreuse qui relie Turtuk, dans la vallée de la Noubra, au village de Thang, à 2,5 kilomètres à peine de la Ligne de contrôle [la frontière de facto qui sépare au Cachemire l’Inde du Pakistan], une inscription sur un rocher massif avertit celui qui passe par là : “L’ennemi vous surveille”. Un peu plus loin sur la piste, d’autres rochers portent les mots d’un poète cher au cœur des Baltis, Qurban Ali, qui vécut entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Un poète qui a écrit sur l’amour, le désir et la vie des Baltis.
D’aucuns trouveront ces inscriptions incongrues, mais pour le peuple balti, qui vit dans certains des villages les plus au nord de l’Inde [ainsi que du Pakistan], elles illustrent les conséquences palpables du conflit indo-pakistanais et les réalités impalpables de sa séparation : c’est un peuple qui navigue dans un présent divisé tout en se raccrochant à un passé commun.
Une douleur transmise entre générations
Depuis l’indépendance en 1947 [quand l’Empire britannique des Indes a été scindé pour donner naissance à l’Inde (laïque, à majorité hindoue) et au Pakistan (une république islamique)], la Ligne de contrôle qui sépare les deux pays a été modifiée à plusieurs reprises, et, chaque fois, le peuple balti a dû se déplacer avec elle. La première “partition” du Baltistan a eu lieu en 1948 [au terme de la première guerre indo-pakistanaise, menée pour la possession du Cachemire]. Puis, après la deuxième guerre indo-pakistanaise, en 1965, les habitants du village de Dreyloung, à 25 kilomètres de Kargil, en plein sur la ligne de feu, ont été déplacés à Latoo. La ligne de démarcation a pour la dernière fois été modifiée pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971, il y a près de cinquante ans.
Le 12 décembre 1971, comme d’ordinaire sur ces terres inhospitalières, la rude nuit hivernale était tombée tôt sur Turtuk, qui faisait alors partie de la région du Gilgit-Baltistan, administrée depuis 1948 par le Pakistan. Une petite fille de 5 ans, Rahim Bi Ashoor, s’accrochait à sa maman qui se précipitait paniquée, en pleurs, à travers les étroites rigoles. Les bombardements dans le village voisin de Chalunka s’intensifiaient au fil des heures. “Je ne le savais pas à ce moment-là, mais ma mère cherchait mon frère aîné, qui faisait partie de l’armée pakistanaise”, se rappelle Ashoor, aujourd’hui âgée de 56 ans.
Un enfant de 5 ans est trop jeune pour se souvenir des tenants et aboutissants politiques d’une guerre, dit-elle. Sa douleur, en revanche, se transmettra à des générations et des générations. “Nous avons fini par le retrouver. Il s’est caché avec nous pendant une semaine dans des grottes, raconte-t-elle :
Mais des soldats indiens sont venus dans notre village. Ils seraient parvenus à l’identifier à cause des armes qu’il avait sur lui. Et ils l’auraient tué. Nous avons dû le laisser partir.”
Des poèmes pour rester soudés
Le 13 décembre 1971, les habitants de cinq villages baltis – Turtuk, Thyakshi, Thang, Pachathang et Chalunka – se sont réveillés en Inde, rejoignant d’autres villages baltis comme Karkitchoo, Hardas et Hundurmaan, qui étaient déjà passés du côté indien. La ligne de partage avait encore été déplacée. Et certains villages, trop proches de celle-ci, allaient rester coupés de l’administration indienne et pakistanaise pendant des décennies – Turtuk n’a ouvert ses portes aux touristes indiens qu’en 2010, soit près de quarante ans après la guerre.
Aujourd’hui, la majorité des 500 villages où vit le peuple balti se trouve au Pakistan. Quelque 9 000 familles vivent séparées. Et, cinquante ans plus tard, le souvenir de la séparation reste vif. À noter que, en Inde, il existe aussi des petits groupes baltis dispersés à travers l’État de l’Uttarakhand [plus au sud], dans des régions comme Chakrata et Kalsi Gate ; ils s’y étaient installés pour travailler comme ouvriers du bâtiment pour les Britanniques. Selon une étude menée en 2008, l’Uttarakhand comptait alors près de 2 500 Baltis.
En dépit de la partition, le peuple balti est resté soudé. Notamment grâce à sa culture et à sa poésie. “Ma famille, ma terre, ma langue se trouvaient de l’autre côté, au Pakistan, après la partition, mais, moi, je suis resté en Inde, explique le grand poète balti et militant Bashir Wafa, qui a grandi à Kargil :
Il nous reste encore notre culture. Maintenant que tout est cassé, que tout a éclaté, il nous reste notre poésie, nos rituels, nos histoires et notre histoire. C’est ce qui nous aide à survivre. C’est ce qui nous unit.”
“Vivre, c’est bâtir une maison sur un rocher glissant”
Voilà pourquoi la poésie de Qurban Ali demeure si vivante. Il est né en 1846 dans le village de Turtuk, qui faisait à l’époque partie de l’État princier du Jammu-et-Cachemire [un État dirigé par un monarque local qui avait prêté allégeance à la Couronne britannique, et qui, à ce titre, jouissait d’une relative autonomie]. Turtuk était une oasis commerciale, culturelle et agricole au milieu des montagnes du Karakoram. Ce village situé sur la route de la soie produisait des abricots et du sarrasin, que ses habitants échangeaient contre de l’huile, du riz et d’autres produits essentiels. En 1935, le maharaja a cédé la région aux Britanniques et, après la partition, Qurban Ali a fini sa vie à Turtuk, qui se trouvait alors côté pakistanais.
Le poète compte parmi les premiers habitants de Turtuk à avoir reçu une instruction. Enfant aux multiples talents, il récitait des versets du Coran avec la même facilité qu’il tissait les plus élaborées des couvertures, réalisait d’exquises sculptures en bois et jouait au polo. Mais ce que ses semblables appréciaient par-dessus tout, c’était ses dons de conteur et de poète. Qurban Ali est mort à 105 ans, dans les années 1950. Si la poésie de cet homme qui a connu différents régimes n’est pas politique de prime abord, elle est le reflet de cette riche existence. “Si l’on regarde le monde avec les yeux de l’âme, on voit qu’il n’appartient à personne / Vivre, c’est bâtir une maison sur un rocher glissant.” Des vers qui se révéleraient prophétiques.
Des émotions et des affects niés par l’État
Les fractures créées par les trois guerres indo-pakistanaises de 1947, 1965 et 1971 peuvent sembler très abstraites vues d’aujourd’hui. Mais la réalité, ce sont des enfants qui, un beau jour, se réveillent avec un autre gouvernement que celui que connaissaient leurs parents, des hommes qui doivent envoyer par la poste une lettre de divorce à des épouses qui leur sont devenues étrangères, des membres d’une même famille qui ne se connaissent plus – qui ne voient désormais les noms des êtres qui leur sont chers que de loin en loin, dans des lettres leur annonçant des mariages et des décès.
Comme le souligne Radhika Gupta dans son article “Poetics and Politics of Borderland Dwelling : Baltis in Kargil” (2014) [“Poésie et politique des zones frontalières : les Baltis de Kargil”, inédit en français ; Radhika Gupta est une anthropologue spécialiste de l’Inde, aujourd’hui chercheuse à l’université allemande de Göttingen] : “Les formes culturelles, en particulier la poésie, circulent de part et d’autre de la frontière malgré les restrictions imposées aux mouvements des personnes. La plupart des poèmes traitent de thèmes romantiques et quotidiens, sans nécessairement exprimer de désir pour ce qu’il y a de l’autre côté de la frontière. La persistance d’un espace culturel commun à cheval sur cette frontière permet aux Baltis d’exprimer les émotions et les affects niés par l’État.”
Aujourd’hui, les Baltis d’Inde cherchent à préserver leur histoire commune avec leurs frères du Pakistan – une histoire qui fait abstraction de la frontière. Toutes les générations, les plus vieilles comme les plus jeunes, imaginent des façons réelles ou virtuelles d’y parvenir. Au Ladakh, par exemple, le village de Turtuk abrite le musée de l’Héritage balti, lequel a été fondé en 2017 par les fils de Rahim Bi Ashoor. Aménagé dans leur maison vieille de 140 ans, il présente des pièces de la vie traditionnelle – objets en grès, vêtements et chapeaux travaillés, outils et ustensiles divers, éléments de décoration. À Hundurmaan, à 450 kilomètres de là, le musée de la Mémoire Unlock Hundurmaan abrite des objets issus de la guerre de 1971 mais aussi des jeux et des accessoires baltis traditionnels.
Le pouvoir de la musique baltie
Le musicien et compositeur Fazil Abbas, 48 ans, est constamment à la recherche de manières innovantes de contrer l’oubli de la culture des Baltis en Inde. Policier le jour, Fazil Abbas est l’arrière-petit-fils de Qurban Ali. Il écrit des chansons que les étudiants et les artistes aiment chanter. Il a par ailleurs créé la page Facebook “Turtuk at a glance” [“Turtuk d’un seul coup d’œil”], qui compte aujourd’hui pas loin de 3 000 abonnés, pour garder cette culture en vie et rassembler la communauté. Pendant le confinement lié au Covid-19, une étudiante en musique de Leh, Stanzin Chhosdon, 23 ans, a chanté une des chansons de Fazil Abbas et a posté son enregistrement sur le groupe “Turtuk at a glance”. “La région du Ladakh compte beaucoup de Baltis, mais, avant, je ne m’intéressais pas du tout à leur culture. Cette chanson est magnifique, et j’espère que grâce à l’intérêt de jeunes issus d’autres ethnies, comme moi, la culture baltie pourra être préservée.”
L’historien Sadiq Hardassi, 55 ans, a grandi à Hardas, un village frontalier du district de Kargil [qui se trouvait dans son enfance côté pakistanais]. Il se souvient de l’époque où il étudiait le Coran dans la maison d’un voisin. Un jour où la radio Skardu, écoutée par toute une génération de femmes qui ne comprenaient pas l’ourdou [la langue officielle du Pakistan], a retransmis une mélodie baltie, il a vu sa professeure sangloter. “Je n’en avais aucune idée à l’époque, mais, plus tard, j’ai appris que c’était une chanson nostalgique et que, lors de la partition de 1947, le mari de ma professeure avait dû rester de l’autre côté de la frontière, raconte-t-il. Tel est le pouvoir de la musique baltie.”
Depuis toujours, cette musique parle de nostalgie. Autrefois, quand les hommes conduisaient les caravanes de yaks et de chevaux pour aller les vendre, et, plus tard, quand ils traversaient les régions montagneuses de Shimla et de Dehradun pour aller travailler pour les Britanniques, ils étaient séparés de leurs femmes – souvent, pendant des années. “À l’époque, il n’y avait ni lettres ni bureaux de poste, rappelle l’historien. Les femmes du Baltistan allaient trouver d’autres hommes qui se rendaient dans les régions où travaillaient leurs fils, leurs époux et leurs frères et leur demandaient de leur transmettre une chanson. Tout le monde connaissait la signification de ces chansons. Celle qui s’appelle Shikhani Kofpa, par exemple, signifie que le mari manque à sa femme. D’autres chansons signifient que la famille est en bonne santé.”
L’Islam, religion dominante depuis le XVIIe siècle
D’un point de vue culturel, le Baltistan mêle les traditions tibétaine, animiste et bouddhiste. Ses habitants célèbrent encore les quatre fêtes saisonnières traditionnelles : Navroz, le 21 mars, où le jour et la nuit sont de même durée ; Struf hla, le 21 juin, le jour le plus long de l’année ; Maizan, le 21 septembre, lorsque les cultures sont prêtes à être récoltées ; et Losar, le 21 décembre, qui correspond au nouvel an balti. Aujourd’hui, des festivités sont organisées à ces dates à Turtuk – même si ce n’est plus en grande pompe.
L’Islam est devenu la religion dominante du Baltistan à la fin du XVIIe siècle, lorsque des missionnaires musulmans du Cachemire ont sillonné la région. Ils ont notamment apporté les fêtes de l’Aïd et le mois sacré de mouharram – une majorité de la population baltie est chiite. Aujourd’hui, les Baltis continuent de célébrer nombre de leurs fêtes traditionnelles, en y ajoutant une touche musulmane. À Navroz, par exemple, on bat un tambour avant l’appel à la prière du matin ; des processions, des numéros de danse et des concerts se déroulent tout au long de la journée et, le soir, se joue le traditionnel match de polo. Côté littérature, l’influence persane a apporté le ghazal [“poème d’amour”], la qasida [“ode”] et le marsiyya [“poème élégiaque”]. Puis, peu à peu, dans le Baltistan divisé, la poésie a pris un ton plus politique.
“Mon cœur pleure à la vue de mon village détruit”
Contrairement aux mouvements nationalistes au Pakistan, qui appellent à un retour au “Grand Ladakh”, et “contrairement aux mouvements culturels de la région pakistanaise du Gilgit-Baltistan qui veulent se distinguer de l’État musulman du Pakistan, les Baltis du Ladakh cherchent depuis longtemps à consolider leur place en Inde”, remarque Radhika Gupta. Les poètes baltis écrivent en effet nombre de chants patriotes. Reste que même s’ils affirment leur sentiment d’appartenance à l’Inde, le souvenir du conflit les hante.
Le poème Khashmeid Zamana (“Monde sans cœur”), de Sibte Hassan Kalim, qui a grandi à Latoo, en est une belle illustration. “Mon cœur pleure à la vue de mon village détruit / À la vue de la peur sur le visage d’un enfant quand éclate un obus / À la vue des villageois qui fuient la nuit dans les montagnes / Mon cœur pleure, oh monde sans cœur.” “Leur sentiment d’enracinement est manifeste dans des phrases comme ‘J’aimerais mourir ici’, si caractéristiques des migrants et des membres de la diaspora. Pour eux, l’envie de mourir dans un pays, à défaut d’y être né, marque un sentiment d’appartenance”, poursuit Radhika Gupta.
Une tristesse et une joie indicibles
Quelques années après la modification de la Ligne de contrôle en 1971, Fatima Banoo, 97 ans, a fait un rêve : “J’ai rêvé que, alors que mon fils était en train de tomber dans le vide, je le rattrapais. En un sens, mon rêve s’est réalisé.” Quand la guerre a éclaté, son fils aîné, Mohommad Bashir, travaillait comme ingénieur son à la radio Skardu. Elle est restée sans nouvelles de lui pendant des années. Comme tant d’autres, il était resté de l’autre côté. Puis il a commencé à lui envoyer des lettres. Et, quarante-deux ans plus tard, en 2013, après des démarches sans fin pour obtenir un visa, il a réussi à se rendre au Ladakh en passant par Wagah [seul poste-frontière terrestre entre l’Inde et le Pakistan] : il a parcouru 4 000 kilomètres pour retrouver sa mère.
“Des personnes de tout Turtuk sont venues l’accueillir à l’aéroport local de Leh. Elles étaient en larmes en voyant un des leurs revenir du Pakistan”, se souvient son fils cadet, Fazil Abbas. Fatima Banoo raconte qu’elle a failli s’évanouir à la vue de son fils. Elle s’est sentie envahie par une immense tristesse, une tristesse contenue pendant des années, et une indicible joie, qu’elle savait cependant de courte durée, car son fils allait devoir repartir :
Ma vie touche à sa fin, et plus jamais je ne verrai mon fils. Sa famille vit là-bas. Je me suis accrochée aussi longtemps que j’ai pu à la vie d’avant, mais, aujourd’hui, je n’ai plus d’espoir.”
La lutte pour préserver indentité et dialecte
La perte de la “vie d’avant”, voilà le point commun auquel s’agrippe la communauté baltie, même si la nouvelle génération s’adapte à la vie moderne. Les plus vieux habitants de Latoo, Api Rahima et Api Zahra, nés il y a près de quatre-vingt-dix ans, se souviennent avec émotion du Baltistan uni, où ils ont passé une enfance heureuse à pêcher dans les cours d’eau et à jouer à tipcat [sport courant en Inde qui consiste à frapper un petit bâton avec un bâton plus grand pour le lancer à distance] – parfois, ils remplaçaient le bâtonnet par un os de chèvre sacrifiée au nouvel an, lors de la fête de Losar.
Tandis que les jeunes portent leurs regards ailleurs, qu’ils se marient avec des membres d’autres ethnies, qu’ils apprennent des langues, partent étudier et travailler dans d’autres régions, la langue baltie s’enrichit d’influences ourdoues, hindies et anglaises. Les tenues traditionnelles en peau de chèvre et en laine laissent peu à peu place à des vêtements en polyester. Et, côté musique, la pop et les tubes de Bollywood sont rois. Mais certains font de la résistance. “La lutte a commencé quand des militants ont demandé que le balti fasse partie des langues régionales inscrites dans l’article de la Constitution de l’Inde accordant une forme d’autonomie au Jammu-et-Cachemire [jusqu’à que cet État ne perde en 2019 ladite autonomie et soit divisé en deux territoires placés sous le contrôle direct du gouvernement fédéral indien : le Ladakh et le Jammu-et-Cachemire. Voir encadré ci-dessous]. Les Baltis, qui sont devenus une minorité, cherchent depuis activement à préserver leur identité et leur dialecte”, note Radhika Gupta dans un article intitulé “The Importance of Being Ladakhi” [“De l’importance d’être Ladakhi”, non traduit].
En 1997, un groupe de militants soutenus par l’éminente famille Munshi, de Kargil, a fondé Kasco, l’organisation sociale et culturelle de Kargil. “Ils se retrouvent pour mettre en musique des poèmes traditionnels et écrivent de nouvelles chansons. Ils ont aussi formé une petite troupe de théâtre qui joue à diverses occasions, notamment lors de cérémonies officielles. Les spectacles donnés par des artistes en costume traditionnel – et plus généralement tout ce qui touche aux cultures traditionnelles – sont en vogue en Inde, et ils bénéficient du soutien de l’État”, souligne Radhika Gupta.
À Latoo, Leela Banoo, 47 ans, mise sur la culture baltie pour gagner sa vie et émanciper les femmes : “Je fabrique des vêtements, des jouets et divers objets traditionnels. Une robe, une guncha, se vend autour de 2 500 roupies [28 euros] et un couvre-chef autour de 700 roupies [8 euros]. Des gens venus de tous les villages m’en achètent pour les grandes occasions.” Et elle forme à la couture des femmes qui, cette nouvelle compétence en main, pourront gagner leur indépendance financière.
Le rôle crucial des réseaux sociaux
L’avènement des réseaux sociaux – et la progression des couvertures téléphoniques et Internet – donne un coup de fouet à cette tendance. Alors qu’il devient de plus en plus facile de se connecter à Internet, les Baltis adoptent avec enthousiasme les nouvelles technologies et constituent des groupes en ligne. Ils partagent des vidéos de mushairas [festivals de poésie] et envoient des messages à des membres de leur famille dont ils sont séparés, postent des chansons, des poèmes ou juste des informations – bref, la diaspora baltie se réunit sur le Net.
À cause de la pandémie de Covid-19, le peuple balti a perdu un de ses plus éminents poètes et militants. Ustad Sadiq Ali Sadiq, dont les poèmes occupent une place d’honneur dans tous les mushairas, était une sommité de l’histoire de la littérature orale baltie. Sa disparition et d’autres, de même que les difficultés posées par la fermeture de la route qui relie Kargil à Skardu [l’axe, long de quelque 170 kilomètres, est coupé depuis 1948, ce qui oblige les familles séparées de chaque côté de la frontière à un très long détour de 2 700 kilomètres, en passant par New Delhi et Islamabad, si elles veulent se rencontrer], ou encore l’interdiction pour les Baltis d’Inde de téléphoner à leurs proches qui vivent dans des villages de l’autre côté de la frontière, en découragent plus d’un. Reste que, en Inde, le peuple balti est déterminé à faire survivre sa culture, tout comme il a lui-même survécu aux guerres. “Avec nos groupes WhatsApp, nos mots, nos chansons et notre espoir, nous sommes éternels”, souffle le poète Bashir Wafa.
À la sortie de Turtuk, un vers du poète Qurban Ali, inscrit de ses propres mains sur un rocher, en persan, fait écho à cette flamme : “Mes mots me survivront.” Oui, ses mots lui ont survécu, et, espérons-le, ce peuple oublié lui survivra aussi.
Contexte
UN CONFLIT À SOMME NULLE
Revendiqué par l’Inde, le Gilgit-Baltistan correspond à la plus grande partie du Cachemire passée en 1948 sous administration pakistanaise. Le 1er novembre 2020, Imran Khan, Premier ministre du Pakistan, a annoncé son intention de “réformer la Constitution” pour faire de ce territoire autonome “une province à part entière” de son pays, raconte The Express Tribune, un quotidien de Karachi. Quinze jours plus tard, son parti, le PTI, gagnait haut la main les élections régionales qui s’y tenaient.
Ce prochain changement de statut est interprété comme une tactique électorale, mais aussi comme une riposte à la mise sous tutelle de la partie indienne du Cachemire par le gouvernement Modi, en août 2019, et à sa scission entre le Ladakh et le Jammu-et-Cachemire. “L’Inde s’oppose à l’octroi du statut de province au Gilgit-Baltistan, considérant que ce dernier est une partie intégrante de l’Inde”, souligne l’hebdomadaire indien The Week.
Présents des deux côtés de la Ligne de contrôle qui coupe le Cachemire en deux, les Baltis ne se sont pas vu demander leur avis sur l’une et l’autre de ces initiatives.